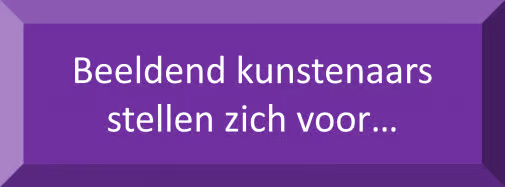RATATOUILLE n. f. est probablement formé (1778) sur le verbe touiller* autour duquel s’est formé
dans les patois un ensemble foisonnant de verbes expressifs, quelquefois avec des syllabes de
renforcement comme fertouiller, tantouiller, entouiller, tartouiller, tatouiller, ratouiller, patouiller,
et dont la signification tourne autour de « se vautrer, agiter un liquide, tremper, salir ». P. Guiraud,
en acceptant le croisement avec touiller, fait de ratatouille le déverbal d’un °ratatouiller, doublet de
ratatiner*, qui serait formé de re- à valeur intensive et perfective, de la racine tatt- « tripoter » et de
l’élément -ouiller à valeur fréquentative.
. Le mot a d’abord désigné péjorativement un ragoût grossier, sens qui s’est élargi à « mauvaise
nourriture ». En gardant sa valeur péjorative, il a pris le sens figuré de « mélange douteux,
suspect » (1880). . Celui de « volée de coups, raclée » (XXe s.) est en rapport avec tatouille.
¦ En cuisine, le mot a aussi le sens non péjoratif de « ragoût », s’appliquant au XIXe à divers
types de plats régionaux, et au XXe s. à l’un d’entre eux, fait de légumes cuits, appelé ratatouille
niçoise ou simplement ratatouille.
. Le mot est abrégé familièrement en RATA n. m. (1828), mot qui a désigné un ragoût de pommes
de terre et de haricots, puis péjorativement un mélange de viande et de légumes servis à l’armée
(fin XIXe s.). La locution figurée ne pas s’endormir sur le rata signifie « être diligent » (1928) ; elle
a vieilli. Rata désigne en général une mauvaise pitance (1833) ; en ce sens, il s’est employé au
féminin. Légèrement archaïque, il fait aujourd’hui allusion à un ordinaire militaire déplaisant
Bron: Dictionnaire Historique de la Langue Francaise – A. Rey (Le Robert, 2011)
Hoor je het ook eens van een ander.
janv